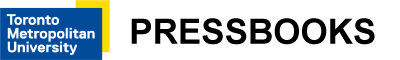Chapter 2
Cap sur des perspectives anti-oppression dans les évaluations de la santé
|
Pour comprendre en quoi consiste l’anti-oppression, il convient d’abord de comprendre ce qu’est l’oppression. |
Oppression
L’oppression s’entend de tout usage injustifié du pouvoir et des privilèges pour faire stagner les autres sur les plans social, politique et psychologique. Ainsi définie, l’oppression se manifeste par des interactions démoralisantes, des politiques/pratiques discriminatoires et exclusives, le déni d’accès aux ressources et des stéréotypes qui, relayés par le public, constituent des obstacles aux débouchés, à la croissance, à l’acceptation et à la reconnaissance de certains groupes de la société (Banks & Stephens, 2018).
L’oppression est souvent conceptualisée en opposition au privilège qui peut être défini comme l’accès non mérité et sans entrave aux ressources, au respect, à l’acceptation et aux possibilités dont ne bénéficient pas les autres du fait de leur caractère exclusif.
L’oppression et le privilège sont des lois non écrites qui, exercées sciemment ou non, conditionnent notre façon de penser et d’interagir avec ceux qui sont perçus par la société comme étant « différents ».
L’oppression, à la fois vécue et ressentie, est sociale, voire structurelle, c’est-à-dire que l’oppression sociale s’opère à tous les niveaux et dans tous les systèmes de la société, mais qu’elle est vécue au niveau individuel ou du groupe sous forme d’impuissance, de traumatisme, de sentiment de nullité et de lutte inexpiable pour la reconnaissance et l’acceptation. Au Canada, cette lutte a légué un héritage de résilience et de résistance, notamment au sein des populations racialisées et autochtones, mais la persistance des obstacles structurels et des préjugés personnels a, pour ces groupes, eu des conséquences, dont des traumatismes et des maladies (Matheson et al., 2019).
Le racisme anti-Noirs, enraciné dans l’esclavage, et le racisme anti-Autochtones, ancré dans le colonialisme, tous deux des formes d’oppression connues qui engendrent des maladies, se traduisent souvent, dans le vécu, par une diminution des possibilités d’éducation et d’emploi, une augmentation des taux d’incarcération et une plus grande vulnérabilité à la violence, sans compter que les enfants noirs et autochtones ont une probabilité plus élevée de se retrouver dans le système de protection de l’enfance (Matheson et al., 2019). Autant d’expériences qui font que ces populations s’exposent à de plus grands risques de se retrouver aux prises avec le système de santé.
Anti-oppression
En vous engageant auprès des clients comme le veut le parcours de la santé et de la guérison, efforcez-vous de vous centrer sur les pratiques réparatrices en cherchant à reconnaître et à interrompre le flux des conséquences négatives de la discrimination, du racisme, de la colonisation et de l’injustice sociale. En tant que membre du personnel infirmier, vous devriez agir en faisant preuve de sensibilité culturelle, de compétence culturelle, d’humilité culturelle et de sécurité culturelle, tout en assumant vis-à-vis des pratiques anti-oppressives une responsabilité professionnelle primordiale.
En effet, un cadre de pratique anti-oppression est un engagement global envers la justice sociale et de l’épanouissement de la dignité humaine.
Lorsque vous appliquez une optique anti-oppression à une évaluation de la santé, vous aurez alors une conscience aiguë des nombreuses façons dont les inégalités face à la santé peuvent nuire à la santé des clients, à leur vision du monde, à leurs réactions et à leurs interactions. Un tel éclairage, en vous aidant à ne pas faire stagner le processus de guérison du client, vous incitera à prendre des mesures pour contrer les pratiques discriminatoires et exclusives du système de santé qui pourraient entraver l’accès du client à des soins équitables.
Contextualisation selon a culture
Prenons l’exemple des jeunes Noirs de Toronto, touchés sans commune mesure par la violence armée, au regard du nombre de décès et de blessures, et qui, du fait de la stigmatisation sociale de cette expérience aux effets négatifs, s’exposent souvent à des soins empreints de préjugés négatifs de la part des professionnels de la santé (Khenti, 2018). En évaluant un jeune homme noir blessé, le personnel infirmier attentif aux concepts de la culture comprendra que le facteur racial l’expose à ce type de blessure et que, dans une perspective anti-oppression, les inégalités raciales et la stigmatisation sociale associées à ce type de blessure peuvent influer non seulement sur le point de vue qu’ont les professionnels de la santé du jeune homme, mais aussi leurs interactions avec lui, ce qui l’expose à des soins à caractère discriminatoire et empreint d’exclusion. Une telle prise de conscience pourrait inciter le personnel infirmier à recueillir les informations nécessaires pour plaider en faveur du client, c’est-à-dire des ressources utiles au maintien de la santé, et aider tous les membres de l’équipe de soins à lui assurer une prise en charge, alliant ouverture et empathie.
Activité: Vérifier sa compréhension
Références
Banks, K. H., & Stephens, J. (2018). Reframing internalized racial oppression and charting a way forward. Social Issues and Policy Review, 12(1), 91-111. https://doi.org/10.1111/sipr.12041
Khenti, A. A. (2018). Three decades of epidemic black gun homicide victimization in Toronto: Analyzing causes and consequences of criminological approach. (Doctoral dissertation). https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/handle/10315/34979
Matheson, K., Foster, M. D., Bombay, A., McQuaid, R. J., & Anisman, H. (2019). Traumatic experiences, perceived discrimination, and psychological distress among members of various socially marginalized groups. Frontiers in Psychology, 10, 416.https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00416