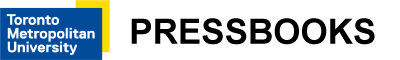Chapter 2
Évaluations inclusives de la santé en présence de personnes LGBTQI2SA+
Case Application: Cody
https://soginursing.ca/eresource/index.html#/lessons/rf4jDfaDQfwab1IIq3E6xF6zF-9o4jkT
En quoi la réalité vécue par Cody aurait-elle pu être différente?
En revanche, il est important d’avoir une compréhension même élémentaire de ce qu’est l’identité de genre, c’est-à-dire la perception que l’on a de son genre, assimilée souvent au fait d’être homme ou femme, et qui peut être classé comme cisgenre, une personne dont l’identité de genre coïncide avec son sexe à la naissance, ou transgenre, une personne dont l’identité de genre ne correspond pas à leur sexe de naissance (Bourns, 2019). Les personnes qui se disent non binaires peuvent ne pas s’identifier à un homme ou à une femme, ou ne s’identifier à aucun genre, ou à un genre autre que masculin ou féminin, ou à plus d’un genre (James et al., 2016). Au sein de la population autochtone, les personnes dites bispirituelles peuvent décrire leur identité de genre, sexuelle ou spirituelle comme étant celle d’une personne qui incarne à la fois un esprit masculin et féminin (TransCare BC, 2017).
S’agissant de la sexualité, celle-ci a trait à l’expérience d’une personne et à la façon dont elle s’exprime sexuellement. Lorsqu’elle évoque son orientation sexuelle, elle le fait en fonction du sexe auquel elle est attirée. Les personnes qui sont attirées par le sexe opposé se disent hétérosexuelles, tandis que celles qui sont attirées par le même sexe se disent homosexuelles. Les personnes qui éprouvent une attirance pour les deux sexes peuvent s’identifier comme bisexuelles (Rainbow Health of Ontario, 2020). L’hétéronormativité consiste à supposer que l’hétérosexualité est la norme, laquelle est encore répandue (Searle, 2019), encore qu’il faille bien se garder des présomptions hétéronormatives lorsque vous procédez à une évaluation de la santé.
Contextualisation selon la culture
Par exemple, imaginez que vous êtes en présence d’une jeune femme de 18 ans, dont l’identité pronominale est « elle », et en train de faire une évaluation de la santé. Si vous lui demandez si elle a un petit ami, alors que vous l’interrogez sur son activité sexuelle, vous avez fait une présomption hétéronormative, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la confiance et la relation infirmière-client. Demandez-lui plutôt si elle est sexuellement active, avec qui elle a des rapports sexuels et quelle est son orientation sexuelle.
La stigmatisation, la discrimination, l’homophobie et la transphobie se sont conjuguées pour créer à l’endroit des personnes LGBTQI2SA+ l’isolement social et des problèmes de santé mentale, sans parler des risques de suicide. Dès lors, il est vital de vous assurer que l’environnement qui préside à chaque évaluation de la santé est porteur d’inclusion et respectueux de l’égalité des sexes.
Voici quelques stratégies propres à favoriser des évaluations inclusives de la santé en présence des personnes LGBTQI2SA+:
- Avant chaque interaction, méditez sur les croyances ou les présomptions que vous avez au sujet des personnes LGBTQI2SA+ et sur la manière dont elles peuvent fausser les principes de l’évaluation inclusive de la santé.
- Lorsque vous rencontrez un nouveau client, présentez-vous en disant votre prénom (nom) et votre identité pronominale, puis demandez à cette personne de vous dire les siens, c’est-à-dire par quel prénom (nom) et quel pronom elle s’identifie. Une telle approche a l’avantage de normaliser l’identité de genre et réduit la stigmatisation à l’endroit des personnes transgenres et au genre , c’est-à-dire.
- Lors d’une évaluation, et s’agissant du choix des mots désignant les parties de son corps, demandez au client ses préférences. L’emploi du terme « organes génitaux » au lieu de « vagin » ou « pénis » peut revêtir une grande importance pour les personnes transgenres et non binaires (Bosse et al., 2015).
References
Bosse, J., Nesteby, J., & Randall, C. (2015). Integrating sexual minority health issues into a health assessment class. Journal of Professional Nursing, 31, 498-507. http://doi.org/10.1016/j.profnurs.2015.04.007
Bourns, A. (2019). Guidelines for gender-affirming primary care with trans and non-binary patients. http://www.transforumquinte.ca/downloads/Guidelines-and-Protocols-for-Comprehensive-Primary-Care-for-Trans-Clients-2019.pdf
Rainbow Health Ontario (2020) LGBT2SQ terms and definitions glossary. https://www.rainbowhealthontario.ca/news-publications/glossary/
Searle, J. (2019). Queer phenomenology, the disruption of heteronormativity, and structurally responsive care. Advances in Nursing Science, 42(2), 109-122. https://doi.org/10.1097/ANS.0000000000000258
The Trans PULSE Canada Team (2020). Health and health care access for trans and non-binary people in Canada. https://transpulsecanada.ca/research-type/reports
Trans Care BC. (2017). Gender-affirming care for trans, Two-Spirit, and gender diverse patients in BC: A primary care toolkit. http://www.phsa.ca/transcarebc/Documents/HealthProf/Primary-Care-Toolkit.pdf
Les personnes qui ne se conforment pas aux idées ou stéréotypes d'autrui quant à leur apparence ou leur compor-tement selon le sexe qui leur a été attribué à la naissance.