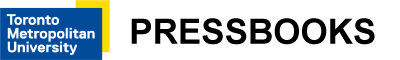Chapter 2
Qu’est-ce qu’une évaluation inclusive?
Pour répondre à cette question, il nous faudra d’abord commencer par en situer la pertinence dans le contexte de la justice sociale.
L’existence humaine est définie par les différences, soit la diversité des personnes, du vécu, des cultures et des perspectives. La justice sociale est le plus souvent définie au sens d’équité en termes de possibilités, sans considération des différences.
En revanche, l’injustice sociale est ancrée dans les différences et a entraîné de terribles souffrances humaines dans notre société, ces injustices, le plus grand point de faiblesse de l’humanité, se présente sous de nombreuses formes, notamment celles-ci :
- Racisme (à l’endroit, par exemple, des Noirs, des Asiatiques et des Autochtones)
- Inégalité (inégalité fondée, par exemple, sur le sexe, le genre et la race)
Pour certains segments de la société, l’injustice sociale peut se traduire par l’immobilisme social, c’est-à-dire un état de stagnation sociale qui, induit par l’iniquité et l’injustice, entrave leur progrès social et économique du fait de l’accès différencié aux ressources et aux possibilités, de la marginalisation, de l’exclusion et de la discrimination.
D’autre part, l’injustice sociale peut alimenter ce que l’on appelle « l’altérité », le discours sur L’Autre, qui véhicule une mentalité de « nous » contre « eux » (Inokuchi & Nozaki, 2005) et qui, ce faisant, peut engendrer chez les groupes marginalisés un sentiment de nullité et conduire à l’impuissance, à la peur, au stress, aux traumatismes et à la vulnérabilité aux maladies. Vues dans l’optique de la santé, les manifestations extrêmes de l’injustice sociale peuvent inclure des maladies telles que le cancer, les maladies cardiaques, le diabète et les maladies respiratoires. Par exemple, les chercheurs ont démontré que les injustices structurelles découlant du racisme sont à l’origine des disparités constatées dans la prévalence et la prise en charge du diabète, ainsi que dans les décès dus au diabète, parmi les minorités raciales et ethniques.
Si l’on omet de comprendre les racines sociales de la maladie, il devient facile de faire porter aux clients la responsabilité des suites de leur maladie ou même de perpétuer l’injustice inhérente à la façon dont ils sont traités, les pratiques d’évaluation de la santé étant différentes selon les clients, alors que tous les clients devraient avoir le sentiment que leur santé et leurs besoins en la matière sont importants et qu’ils comptent. Les évaluations de la santé doivent procurer aux clients un sentiment de sécurité, de respect et de participation. S’ils se sentent marginalisés ou s’estiment exclus ou traités différemment, cela peut renforcer les injustices sur le plan de la santé et, plus généralement, dans le système de santé.
En d’autres termes, pour être inclusives, les évaluations de la santé devraient s’appuyer sur la justice sociale, le personnel infirmier devant s’attacher à respecter l’humanité de tous les clients, et ce, dans tous les aspects des soins, sans égard à leur appartenance raciale ou ethnique, à leur sexe, à leur sexualité, à leur âge, à leurs capacités et à tout autre facteur qui fait d’eux des personnes à part entière.
Les évaluations inclusives de la santé reposent sur quatre principes clés :
- Chaque évaluation de la santé doit être comprise comme un acte d’humanité: Que signifie l’expression « se faire traiter comme un être humain »? Nous voulons tous être acceptés, nous voir respectés et un sentiment d’appartenance.. Si vous faites ressentir le contraire à un client, vous lui faites subir un acte d’oppression qui peut nuire à sa dignité humaine et à sa capacité de grandir et de se transformer. Il est important de reconnaître que même si la profession infirmière est bienveillante, les infirmières et les infirmiers ont le d’opprimer. En prenant acte des différences entre les clients, vous devez également vous efforcer de démanteler au sein du système de santé les injustices sociales qui font que les clients se sentent dénués de toute humanité.
- Les evaluations de la santé ne consistent pas à établir des similitudes: Chaque client est différent et, de ce fait, les évaluations de la santé doivent aller au-delà des approches « normales » ou types de l’évaluation physique. Il en est ainsi parce que le « normal » est un construit social, une représentation commune qui s’appuie sur des valeurs culturelles et des normes relatives. Dans ce contexte, vous devez en arriver à une compréhension nuancée des expériences de chaque client, tant sur le plan de la santé que celui de la maladie, et l’aider à progresser vers un chemin de guérison. En clair, une évaluation de la santé se veut être plus qu’un examen physique dans la mesure où, en parlant avec le client, recueillant ses antécédents médicaux, vous apprenez aussi à le connaître, ce qui signifie que vous prenez acte du vécu et des connaissances uniques du client et les intégrez dans les soins que vous lui prodiguez.
- Analyse de vos propres préjugés: Tout le monde porte des préjugés, fruit de sa socialisation, lesquels peuvent comprendre des idées reçues sur les différentes races, pratiques culturelles, tailles corporelles ou pratiques religieuses. Ces préjugés peuvent influer sur votre façon de vous tenir pendant une évaluation de la santé et, par conséquent, sur ce que les clients ressentent et sur leur réaction en votre présence. En apprenant à cerner vos propres préjugés — comment ils se sont formés et comment ils influencent vos actions —, vous pouvez comprendre non seulement en quoi ils conduisent à de nouvelles injustices dans la pratique infirmière, mais aussi comment vous vous pouvez commencer à les désapprendre, voire à les neutraliser.
- Maintien d’un milieu de soins sûr: Ce principe vous engage non seulement à créer un milieu où l’accent est mis sur ce qui compte pour le client, mais aussi à aborder chaque client dans un « esprit de recherche » (Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, 2007, p. 26). Gardez donc l’esprit ouvert, alors que vous apprenez à connaître les besoins et les perspectives du client, à l’accepter tel qu’il est, en attachant de l’importance à ses sentiments et à ses expériences, sans le juger. Ce milieu, un espace sûr permet aux clients de s’exprimer sans crainte de se voir juger ou subir de discrimination. En d’autres termes, et plus généralement, les patients se sentiront a plus engagés s’ils ont le sentiment qu’ils collaborent avec le personnel infirmier dans la poursuite d’un objectif commun relatif à ce qui est important pour eux. Se sentant en sécurité, ils verront s’accroître leur estime de soi et leur sentiment d’appartenance qui, dans le système de santé, sont des résultats essentiels.
Clinical Tip
Prenez un moment pour tester vos propres préjugés en passant le test de l’association implicite de Harvard: Implicit Association Test (harvard.edu)
Lorsque vous accédez à ce lien, vous pouvez cliquer sur « Contexte » pour en savoir plus sur les origines et le but de ce test ou cliquer sur « prenez un test » pour tester vos biais.
Ces principes clés, dont vous devriez tenir compte alors que vous procédez à l’évaluation inclusive de la santé, se trouvent exposés dans la Figure 2.1 montrant à quel point ils sont interdépendants. Comme il est indiqué ci-dessus, la justice sociale est la pièce maîtresse de l’évaluation inclusive de la santé et se place donc au centre du diagramme. Fais important, et comme indiqué, la justice sociale est ancrée dans des perspectives anti-oppressives comme nous le verrons plus loin dans le chapitre. Les pointillés qui entourent les principes représentent la corrélation directe entre la pratique de l’évaluation inclusive dans le système de santé et ses répercussions constantes au sein des communautés.

Figure 2.1: Principes de l’évaluation inclusive de la santé (illustration par Levar Bailey).
Activité: Vérifier sa compréhension
Références
Inokuchi, H., & Nozaki, Y. (2005). “Different than Us”: Othering Orientalism, and US middle school students’ discourse on Japan. Asia Pacific Journal of Education, 25(1), 61-74. https://doi.org/10.1080/02188790500032533
Ogunwole, S. M., & Golden, S. H. (2021). Social determinants of health and structural inequities—root causes of diabetes disparities. Diabetes Care, 44(1), 11-13. https://doi.org/10.2337/dci20-0060
Registered Nurses’ Association of Ontario (2007). Healthy work environments best practice guidelines: Professionalism in nursing. Registered Nurses’ Association of Ontario. https://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/Professionalism_in_Nursing.pdf
(préjugés et discrimination fondés sur l'âge, généralement l'âge mûr, à l'encontre de personnes et de groupes)
(préjugé et discrimination à l'encontre des personnes handicapées)
réfère à la capacité d'influencer.